PCEM1
Année 2005-06
Notes
de lecture et résumés.
Robert Nisbet (1913-1996)
Historien de la sociologie. Professeur émérite à
l’Université de Columbia et à l’Université de Californie (Berkeley). Principaux
ouvrages : The Quest for Community (1953), The Degradation of the Academic
Dogma (1971), et Twilight of Authority (1975). Dans La Tradition sociologique, il présente une étude
historique sur l’évolution des concepts fondamentaux qui ont caractérisé la
pensée sociologique au 19e siècle et au début du 20e siècle, à partir des
oeuvres de grands auteurs européens : Tocqueville, Marx, Comte, Weber,
Simmel, etc.
La Tradition sociologique, PUF, 1984
(The Sociological Tradition, 1966)
Édition de poche, PUF, « Quadrige », 2000.
Notes de lecture
Première partie : Concepts et contextes
Nisbet
se livre dans ces deux premiers chapitre à un véritable « discours de la
méthode » dans lequel il va préciser les objectifs, les enjeux du livre,
et les méthodes et outils qu’il compte utiliser dans sa recherche.
Chapitre 1 : Les concepts élémentaires de la sociologie
1.1 Idées et antithèses : chacun des
concepts opératoire retenus par Nisbets fonctionne par couple antithétique.
ENisbet refuse de considérer l’histoire de la
pensée comme un catalogue d’auteurs, dont on examinerait successivement les
thèses. On perd ainsi la cohésion des idées au profit d’un point de vue
biographique, sans intérêt pour l’histoire des idées.
EIl refuse aussi de considérer l’histoire de
la pensée comme un catalogue de théories. Certes on étudie ainsi des systèmes
de pensée cohérent, possédant une structuration interne forte : notion de
modèle d’analyse ou de pattern. Mais on ne peut alors sortir de ce système pour
confronter ces idées à l’autre. D’autre part ces systèmes sont figés.
Choix
de Nisbert : (citation de Arthure O. Lovejoy)
p.
16 « Par histoire des idées j’entends quelque chose à la fois de plus
spécifique et de moins restrictif que l’histoire de la philosophie. (…) elle décompose les différents systèmes
qui se présentent comme des ensembles indissociables afin d’en isoler les
éléments constitutifs, ou ce que l’on pourrait appeler les idées élémentaires »
Il
s’agit de faire dialoguer des systèmes différents en y repérant des concepts
opératoires (les « idées élémentaires »)
p.17 : «Ce qui apparaît alors, ce ne sont pas seulement les éléments
constitutifs de ces systèmes, les idées élémentaires
sur lesquelles ils reposent, mais aussi les
nouvelles associations et les rapprochements qui s’établissent entre différents
auteurs, entre différentes idées ; des affinités mais aussi des
oppositions dont nous n’aurions pas supposé l’existence »
Son approche est donc celle d’une sorte d’épistémologie comparative de la
sociologie.
Le fragment ci-dessous définit clairement
l’objectif de l’ouvrage :
p. 17 « Ce livre
s’attache à analyser des idées élémentaires, en particulier celles qui
caractérisèrent la sociologie européenne dans la période 1830-1900, période
cruciale pour le développement de cette science car c’est alors que des hommes
comme Tocqueville, Marx, Weber et Durkheim posèrent les bases théoriques de la
sociologie contemporaine. »
On
peut y ajouter ce complément
théorique :
p
17 « j’insiste sur ce point (…) nous nous intéresserons aux idées
élémentaires qui me semblent être les fondements sur lesquels s’est constitué
la sociologie de cette époque, en dépit de divergences de vues évidentes entre
les différents auteurs ; à ces idées qui sont restées pertinentes pendant
tout l’âge classique de la sociologie et qui les restent encore aujourd’hui »
Ce
n’est cependant pas une perspective historique :
« l’histoire
ne révèle ses secrets qu’à ceux qui partent du présent » On veut dégager
les « idées élémentaires »
Le
choix des hypothèses de lecture : Mais quels sont les critères auxquels
doivent répondre les « idées élémentaires » ? Elles doivent
être :
-
Générales : elles
doivent apparaître et être pertinentes dans un maximum d’œuvres considérées sur
la période de référence.
-
Durables : elles
doivent être présentes sur la totalité de la période considérée.
-
Caractéristiques :
elles doivent véritablement permettre de caractériser la sociologie face aux
autres sciences.
-
Consistantes : présentes
à plusieurs moments de l’histoire.
Les cinq concepts
fondamentaux de la tradition sociologique
L’ouvrage définit les concepts fondamentaux qui
caractérisent la tradition sociologique et en suit la trace principalement chez
Tocqueville, (1805-1859) Comte (1798-1857),
Durkheim (1858-1917), Max Weber (1864-1923) et Georg Simmel (1858-1918), avec
des incursions chez de Maistre, Marx, Le Play (1806-1882) , Tönnies
(1855 – 1936). Il s’agit des cinq notions suivantes :
![]() communauté#société (chapitre 3)
communauté#société (chapitre 3)
Communauté : géographique (pays) , de
religion (paroisse) , de travail (corporation), de famille ou de culture :
caractérisée par « une cohésion profonde et entière, de nature durable
et affective »» (Tönnies, Communauté et société, 1887) et qui
s’oppose à « société »
(une pseudo-communauté aux liens impersonnels et « contractuels »
regroupant de nombreux individus)
ELe concept de
communauté est un concept essentiel chez Nisbet, dans l’ensemble de son œuvre.
« La communauté traditionnelle, celle de la pré industrialisation, se
distingue par son autosuffisance, que le pouvoir centralisateur a atomisée et
détruite. La recherche d’une communauté où l’autorité n’est pas le pouvoir est
la tragédie moderne de l’homme ». Les allégeances de l’individu (notion
central de son livre) vont au plus proche de son entourage.
![]() autorité#pouvoir, (chapitre 4) Autorité :
ordre interne à une association,
politique, religieuse ou culturelle qui s’oppose à pouvoir, assimilé à force politique, militaire ou bureaucratique
nécessitant une légitimation externe.
autorité#pouvoir, (chapitre 4) Autorité :
ordre interne à une association,
politique, religieuse ou culturelle qui s’oppose à pouvoir, assimilé à force politique, militaire ou bureaucratique
nécessitant une légitimation externe.
![]() statut#appartenance de classe (chapitre
5) Statut : position de l’individu dans la hiérarchie de prestige et d’influence qui caractérise une
communauté, à distinguer de l’appartenance
de classe, à la fois plus étroite
(économique) et plus collective.
statut#appartenance de classe (chapitre
5) Statut : position de l’individu dans la hiérarchie de prestige et d’influence qui caractérise une
communauté, à distinguer de l’appartenance
de classe, à la fois plus étroite
(économique) et plus collective.
![]() sacré#profane, (chapitre 6) Sacré :
notion recouvrant les conduites irrationnelles, de type moral, religieux ou
rituel « auxquelles on attribue une valeur supérieure à leur utilité »,
opposée (Durkheim) à profane,
l’ensemble des activité séculières des hommes, liées au travail, aux échanges,
à la vie sociale.
sacré#profane, (chapitre 6) Sacré :
notion recouvrant les conduites irrationnelles, de type moral, religieux ou
rituel « auxquelles on attribue une valeur supérieure à leur utilité »,
opposée (Durkheim) à profane,
l’ensemble des activité séculières des hommes, liées au travail, aux échanges,
à la vie sociale.
![]() aliénation#progrès (Chapitre 7): aliénation :
situation dans laquelle « l’homme devient comme étranger (alien) à
lui-même et perd son identité lorsque l’on coupe les liens qui l’unissent à sa communauté
et qu’on lui enlève tout sens moral » ; notion opposée ici à progrès, dès lors que l’aliénation
apparaît comme l’effet pervers du développement (industrialisation,
sécularisation, démocratisation, égalisation des conditions, rationalisation du
travail …) des « forces de progrès » .
aliénation#progrès (Chapitre 7): aliénation :
situation dans laquelle « l’homme devient comme étranger (alien) à
lui-même et perd son identité lorsque l’on coupe les liens qui l’unissent à sa communauté
et qu’on lui enlève tout sens moral » ; notion opposée ici à progrès, dès lors que l’aliénation
apparaît comme l’effet pervers du développement (industrialisation,
sécularisation, démocratisation, égalisation des conditions, rationalisation du
travail …) des « forces de progrès » .
« Il
est remarquable qu’aucune de ces cinq notions n’ait joué de rôle important dans
la pensée des XVII et XVIIIe siècles (Lumières) – de Bacon à Condorcet – dont
les préoccupations s’expriment plutôt en termes d’individu, de progrès, de
contrat, de nature ou de raison (au XIXe siècle l’individualisme se prolonge –
philosophiquement – dans l’utilitarisme). »
1.2/ la révolte contre
l’individualisme. Il semblerait que l’histoire de l’humanité témoigne d’un flux et d’un reflux
de ces notions élémentaires que nous venons de dégager. Durant la période qui
va du XVIème siècle à la révolution française, l’individualisme va régner en
maître : (p. 21) « les aspirations morales et politiques de cette
poque étaient exprimées par une série de termes et d’idées bien différents,
comme par exemple ceux d’individu, de progrès, de contrat, de nature ou de
raison ; L’objectif essentiel de tous les penseurs de cette époque, (…)
c’est de libérer l’individu des contraintes sociales héritées du passé et de
libérer la croyance universelle en l’individu conçu comme être naturel, doué de
raison, pourvu de caractéristiques innées et absolument permanentes. »
On conçoit donc que dans un tel contexte, les notions élémentaires citées plus
haut prennent plutôt une signification de valeurs de réaction. Le XIXème siècle retrouvera le débat entre
les divers concepts antagonistes. « Prises
dans leur ensemble, les idées de communauté, d’autorité, de statut, de saacré
et d’aliénation témoignent d’une réorientation de la pensée européenne dont
l’importance est aussi considérable à mes yeux que la réorientation de nature
toute différente, voire opposée qui avait marqué, trois siècles plus tôt, la
fin du moyen-âge et le début du siècle de la Raison. »
1.3/ Trois sensibilités
politiques : libéralisme, radicalisme, conservatisme...
Ces notions ne peuvent être comprises que si on les
replace dans le contexte des grands courants idéologiques aux prises au XIXe
siècle, en particulier le libéralisme, le radicalisme (au sens premier et fort
du terme : le jacobinisme ou le socialisme sont ici des formes de
radicalisme) et le conservatisme :
![]() le
libéralisme : foi en l’individu (et en la supériorité de la libre
entreprise), affirmation de ses droits politiques, civiques et, plus tard,
sociaux. « L’autonomie de l’individu revêt la même importance pour le
libéral que la tradition pour le conservateur et l’usage du pouvoir pour le
radical. »
le
libéralisme : foi en l’individu (et en la supériorité de la libre
entreprise), affirmation de ses droits politiques, civiques et, plus tard,
sociaux. « L’autonomie de l’individu revêt la même importance pour le
libéral que la tradition pour le conservateur et l’usage du pouvoir pour le
radical. »
![]() le
radicalisme, fondé sur le sentiment que « le pouvoir politique peut
être rédempteur si l’on s’en empare pour le purifier et en faire un usage
illimité, même jusqu’à faire régner la terreur, afin de réhabiliter l’homme et
les institutions. A cette conception du pouvoir s’ajoute une foi presque
illimitée dans la possibilité de construire un nouvel ordre social fondé sur la
raison. » Un millénarisme sans contenu religieux (et même laïque,
anti-religieux).
le
radicalisme, fondé sur le sentiment que « le pouvoir politique peut
être rédempteur si l’on s’en empare pour le purifier et en faire un usage
illimité, même jusqu’à faire régner la terreur, afin de réhabiliter l’homme et
les institutions. A cette conception du pouvoir s’ajoute une foi presque
illimitée dans la possibilité de construire un nouvel ordre social fondé sur la
raison. » Un millénarisme sans contenu religieux (et même laïque,
anti-religieux).
![]() le
conservatisme : ce qui est au coeur du conservatisme, c’est la tradition.
« C’est parce qu’il défend la tradition sociale que le conservatisme en
vient à insister sur des valeurs comme celles de communauté, de parenté, de
hiérarchie, d’autorité et de religion, et à pressentir que, une fois que les
forces du libéralisme et du radicalisme auront arraché les individus aux
contextes créés par ces valeurs, la société sombrera dans le chaos et
l’absolutisme. »
le
conservatisme : ce qui est au coeur du conservatisme, c’est la tradition.
« C’est parce qu’il défend la tradition sociale que le conservatisme en
vient à insister sur des valeurs comme celles de communauté, de parenté, de
hiérarchie, d’autorité et de religion, et à pressentir que, une fois que les
forces du libéralisme et du radicalisme auront arraché les individus aux
contextes créés par ces valeurs, la société sombrera dans le chaos et
l’absolutisme. »
Chapitre 2 : Les deux
révolutions
La fin du XVIIIe et le XIXe siècle sont parcourues par
deux révolutions : la révolution démocratique et la révolution
industrielle.
Les thèmes issus de l’industrialisation
Pour Nisbet, les diverses traditions que nous avons
précédemment relevées, conservateurs, libéraux, radicaux se rejoignent bien
souvent dans l’analyse de la révolution industrielle, dans l’analyse du
« modèle anglais » La tradition sociologique retiendra de la révolution
industrielle cinq aspects : « les
conditions de vie et de travail des ouvriers, le changement de nature de la
propriété, la naissance des cités industrielles, les découvertes
technologiques, et enfin l’organisation du travail ».
Les conditions de travail se détériorent « pour
les radicaux comme pour les conservateurs, la caractéristique la plus
fondamentale et la plus choquante du nouvel ordre social était sans aucun doute
la détérioration des conditions de vie et de travail des ouvriers, ainsi que le
fait que le travail se soit brutalement trouvé arraché au cadre protecteur de
la corporation, du village, et de la famille. » (p.41)
Cette affinité entre conservateurs et radicaux se
retrouve aussi à propos du problème de la propriété privée : cette affinité
« apparaît aussi dans l’aversion qu’ils éprouvent pour un certain type
de propriété, la propriété industrielle à grande échelle, -et plus
particulièrement pour ce type abstrait et impersonnel de propriété que
représentent les actions achetées et vendues en bourse. » (p.44)
Sur l’urbanisme « là encore la réalité ne
pouvait donc que donner naissance à une thématique opposant au cadre
relativement simple et stable des cités closes àù s’organisait la vie urbaine
médiéval, et dont certaines gravures gardaient le souvenir les agrégats
tentaculaires, sans formes ni limites précises, dont les villes nouvellement
apparues (…) offraient le spectacle. » (p.46)
Enfin, au titre de cette révolution industrielle, il
faut citer deux thèmes fondamentaux qui feront l’objet « d’affrontements
idéologiques au XIXe siècle, à savoir l’impact du progrès technologique et le
développement de l’organisation du travail en usine. Pour les conservateurs
comme pour les radicaux ces deux phénomènes étaient à l’origine de
transformations qui affectaient les relations historiques entre l’homme et la
femme et menaçaient (ou promettaient) de sonner le glas de la famille
traditionnelle, de transformations qui aboliraient la séparation culturelle
entre ville et campagne et qui, pour la première fois dans l’histoire,
permettraient à l’individu de libérer son énergie productive des contraintes
que lui imposaient jusqu’àlors la nature et la société traditionnelle ».
(p ;47-8)
La démocratie comme révolution
A noter, dans une perspective sociologique, l’aversion
de la Révolution (et de l’Empire) pour les « associations
partielles », les collectivités intermédiaires : les corporations,
mais aussi la famille (lois sur le divorce, sur la propriété, enseignement),
l’Eglise, les associations en général...
« Il n’y a plus de corporation dans l’Etat, il
n’y a plus que l’intérêt particulier de chaque individu et l’intérêt
général. » (Loi Le Chapelier des 14-17 juin 1791) (55-56) Même aversion
chez Rousseau... Et Robespierre insiste pour les que les droits de l’Etat sur
les mineurs priment ceux du chef de famille...
Individualisation, abstraction, généralisation :
« Aucun contact direct ne s’établissant entre eux, la conception que
chacun se faisait de l’autre résultait de l’élimination des caractéristiques particulières
à chaque individu pour n’en retenir que ce qu’il avait de commun avec tous les
autres membres de sa classe » (Ostrogorski, Democracy and the Organisation
of Political Parties, Londres, 1902) (65)
Deuxième partie : Les concepts élémentaires de la
sociologie
Chapitre 3 : LA COMMUNAUTE
Communauté et société
Au XVIIIe siècle (et chez tous les penseurs héritiers
des Lumières) on considère que les traditions communautaires font obstacle tant
au développement économique qu’aux réformes administratives. La société moderne
doit reposer sur l’individu naturel et non sur le paysan ou sur le membre d’une
corporation ou d’une Église. Mais, au XIXe siècle, dans l’oeuvre des
sociologues, l’idée de communauté redevient aussi fondamentale que la notion de
contrat pendant l’âge de la Raison. Au XIXe siècle les nouvelles utopies sont
communautaires ; mouvements religieux, mutuellisme ouvrier...
Hegel
Chez Hegel dans la Philosophie du droit - oeuvre qui
inspirera les travaux ultérieurs des sociologues allemands - le rôle de l’idée
de communauté est considérable. L’État y apparaît comme une communauté de
communautés plutôt qu’un agrégat d’individus.
Auguste Comte
Dans le Système de politique positive, « traité
de sociologie », la référence à la communauté, communauté perdue,
communauté à retrouver, est permanente... « Si pour Marx le socialisme
c’est le capitalisme moins la propriété privée, pour Comte la société
positiviste n’est rien d’autre que la société médiévale moins le
christianisme. » (82) Comte est un des premiers à discerner les origines
sociales du langage, de la morale, du droit, de la religion et même de la
personnalité (à travers les trois relations constitutives de la communauté de
base qu’est la famille : relation filiale, relation fraternelle, relation
conjugale).
C (résumé de la page 79-85)
Lecture :
§1 la communauté est un
concept central pour les sociologues du XIXe, qu’ils utilisent de préférence à
celui de société.
A/
§2 Ainsi Auguste Comte :
Créateur du terme de
« sociologie » et fondateur d’une religion nouvelle : le
positivisme.
Le positivisme n’est que le
point de départ, le présupposé d’un système dont l’aboutissement est la
sociologie, toute entière dominée par l’idée de communauté, qu’il emprunte non
aux lumières mais à une théorie antérieure (tradition conservatrice, attrait
pour les communauté traditionnelles médiévales)
§3 Comte comme beaucoup de
penseurs de son temps est inquiet de l’effondrement des communautés
traditionnelles.
§4 Il est urgent de rétablir
les liens communautaires au sein de la société. Il considère que les principes
de la démocratie sont trop abstraits et comme tels incapables de fonder un
ordre social. Parallèlement il reconnaît cependant le mérite des lumières dans
sa lutte contre l’obscurantisme.
§5 Pourtant à l’encontre de
Marx, Comte veut bâtir son utopie sur le système médiéval à laquelle il ne fait
que soustraire le christianisme.
B/
§6 l’utopie comtienne est
bâtie par homothétie de l’ancien régime :
Ce qui change :
L’aristocrate
est remplacé par l’homme d’affaires
La
religion est remplacée par la science
La
royauté est remplacée par la république
Ce qui demeure :
attachement de Comte aux rituels ; idée de communauté morale unissant les
hommes au sein de la structure sociale.
§7 Cependant sa vision de la
société est plus sociologique qu’utopique. Car pour lui la notion de société
est un élargissement de la notion de communauté. La société n’est pas un
agrégat d’individus. Ils sont eux-mêmes produit de cette société.
§8 rejet de
l’individualisme ; l’individu isolé n’existe pas ; il est le produit
de l’existence communautaire.
C/
§9 La famille cellule de base
de l’ordre sociétaire
§10 La famille
comtienne : famille « unité de relations et de statut »
-
dépasser
une approche sentimentale et affective de la famille
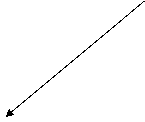
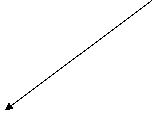 § 11 La famille doit être envisagée sous un jour moral
(socialisation de l’individu, §12)) et
politique (cf. §13)
§ 11 La famille doit être envisagée sous un jour moral
(socialisation de l’individu, §12)) et
politique (cf. §13)
|
§12 Les trois relations -
relation
filiale respect de l’autorité -
relation
fraternelle solidarité sociale -
relation
conjugale ciment social toutes concourent à la
formation de la personnalité de l’individu |
§13 La famille :
approche politique -
structure
interne de la famille -
structure
hiérarchique d’ordre. |
Proposition de
résumé :
Comme
beaucoup de penseurs du XIXème siècle,
Comte, père fondateur de la sociologie et du positivisme réhabilite
l’idée de communauté, qu’il relie, outrepassant la révolution des lumières, à
la tradition médiévale. Il s’inquiète de l’effondrement des liens
communautaire. Certes , la démocratie rationnelle a détruit
l’obscurantisme/50, mais elle a aussi ruiné le ciment de solidarité
qui unissait les individus ; ses principes abstraits sont incapables de
créer un nouvel ordre social. Comte veut revenir à une vie sociale
communautaire purifiée de sa religiosité.
L’utopie
positiviste se modèle sur un communautarisme rénové ; l’homme d’affaires
remplace l’/100aristocrate, la science, la religion, la République,
la royauté ; on réactualise aussi le rituel et le lien communautaire.
Cependant, ce n’est pas qu’une spéculation utopiste : la visée est
sociologique, celle d’une conception de la société comme communauté élargie, où
l’individu est essentiellement défini par ses liens sociaux, /150 il
n’est plus une monade abstraite et isolée, mais le produit de la vie communautaire.
Ainsi,
la famille doit être au fondement de la société. Elle est la cellule où se
définissent les rôles sociaux dont l’individu reçoit son statut. Elle forme la
personnalité de l’individu : il y /200 apprend autorité,
fraternité et solidarité ; elle est
aussi l’archétype de l’ordre social. /214
Le Play
Les ouvriers européens, 1855 :
Il est un des premiers à concevoir l’idée d’une étude
scientifique des sociétés, reprenant en cela une tradition déjà adoptée par
Fourier, Saint-Simon, et Comte. « arithmétique politique » « Le
Play, dans ses études sur les différents types de parenté et de communauté
existant en Europe, s’était efforcé d’associer la méthode déductive à
l’observation empirique et avait clzairement affirmé sa volonté de faire œuvre
de science. (…) (p. 86)
Le Play est le premier à faire entrer l’étude de
données quantitatives dans la compréhension des structures sociales : par
exemple « le recours à sa fameuse technique budgétaire : quel
moyen meilleur et plus exact y a-t-il, (…) d’avoir une connaissance détaillée
de la nature et des activités d’une famille que d’examiner ses recettes et ses
dépenses ? L’établissement du budget des recettes des familles étudiées
permet en outre de procéder à une analyse comparative et quantitative »
(p.87)
C’est également Le Plai qui introduit pour la première
fois l’idée de corrélations au sein des phénomènes sociaux, inaugurant
ainsi la possibilité d’une modélisation rationnelle de sociétés, que l’on
retrouvera chez Marx puis surtout chez Durkheim et Weber. « la
comparaison est en effet l’essence mêe de la méthode de Le Play. Lui même
qualifie celle-ci d’ »observation des faits sociaux », le point
important étant qu’il s’agit d’une observation comparée.»
Cette étude va lui permettre d’aboutir à la définition
de modèles familiaux, qu’il répartit en deux groupes, les familles stables, et
les familles en voie de décomposition, conséquence des deux révolutions.
Distinction entre trois types de familles,
-
famille
patriarcale, (« dominée par le père, l’autorité politique et sociale
trouvant alors rarement son siège en dehors de la famille » p.88) ce type de famille stable est inadapté à
l’ordre social et économique moderne.
-
famille
instable (individualisme, caractère contractuel, absence d’enracinement dans la
propriété)
-
famille
souche synthèse des deux précédentes, puisqu’elle conserve de la première
l’idée d’une autorité d’une seule personne, mais aussi l’idée que chaque enfant
d’une famille peut aussi fonder une nouvelle entité. « elle alie ce
qu’il y a de meilleur dans le système patriarcal à l’individualisme qui
caractérise la famille instable.» (p. 89)
Mais au delà de cette nomenclature, ce qui intéresse
Le Play « c’est le rôle que joue la famille dans l’ordre social. Son
étude vise donc à définir les liens qui l’unissent aux autres instances
communautaires, qu’l s’agisse par
exemple de l’Eglise, de l’employeur, du gouvernement ou de l’école. »
La famille est donc pour lui un modèle communautaire
dont devrait s’inspirer toutes les oautres formes d’organisation sociales et
économiques.
Ferdinand Tönnies :
communauté et société Gemeinschaft
und Gesellschaft, 1887. La société (Gesellschaft) est caractérisée par des
relations contractuelles, utilitaires ; la communauté (Gemeinschaft) par
des relations et une identification affectives.
Max Weber : communauté
de tradition, association d’intérêt
Max Weber reprend et raffine l’analyse de Tönnies. Il
distingue quatre types d’activités sociales suivant qu’elles :
![]() sont
gouvernées par l’intérêt
sont
gouvernées par l’intérêt
![]() s’orientent
vers des fins interpersonnelles ou morales
s’orientent
vers des fins interpersonnelles ou morales
![]() répondent
à des états affectifs ou à des émotions
répondent
à des états affectifs ou à des émotions
![]() relèvent
de la tradition et de la convention
relèvent
de la tradition et de la convention
Les deux types d’associations (communauté ou société)
existent à toutes les périodes de l’histoire de l’humanité... ce sont des
« types idéaux » (des concepts, en somme). La communauté repose sur
le sentiment subjectif qu’ont les parties de s’appartenir mutuellement, d’être
pleinement impliquées dans l’existence de l’autre.
Weber donne pour exemples, outre des types aussi
évidents que la famille, la paroisse et le voisinage : l’unité militaire,
le syndicat ouvrier, la fraternité religieuse, la relation amoureuse, l’école
et l’université. Une « société », quand elle dure, tend à s’imprégner
d’un esprit communautaire (et inversement : une communauté peut
fonctionner, en certaines circonstances comme une société, dans un but
utilitaire)...
Weber distingue enfin des relations sociales ouvertes
et fermées (vers l’extérieur) - distinction qui ne recouvre pas la
précédente : il existe des « sociétés » (société commerciale,
clubs privés...) fermées - même si elles sont, le plus souvent, ouvertes...
La cité antique est une association de communautés
(groupes ethniques ou familiaux) ; la cité médiévale, déjà, une
association d’individus (chrétiens...), « une association confessionnelle
d’individus croyants et non une association rituelle de groupes de
parenté. » (Weber)
Proposition de résumé :
Weber précise la distinction posée par Tönnies entre
société et communauté.. Il distingue les groupements sociaux d’intérêts, de
ceux qui poursuivent des fins collectives, de ceux qui sont motivés par des réactions
affectives, de ceux, enfin, qui relèvent de la culture. La société, reposant
sur le contrat, correspondrait au
premier et au dernier cas, la communauté suppose au contraire un sentiment
subjectif d’appartenances mutuelles.
Relèvent de la communauté les groupements
traditionnels de la famille, la paroisse, mais aussi, à l’époque moderne, la
fraternité des armes ou de la foi, le syndicalisme, la relation amoureuse, et
l’esprit de corps tel qu’il se développe dans les écoles. Dans la sociétés, les
membres sont unis contractuellement parce qu’ils ont des intérêts communs. Mais
une telle union ne peut durer sans que s’y substitue un esprit communautaire.
Mis on peut dire que dans l’histoire le passage de la
communauté des communauté (cité antique) à la société de communauté, (cité
médiévale) puis à la société des individus s’est aussi faite autour du caractère
endogène ou exogène de ces groupements. Quand les membres d’une communauté ne
sont plus regarder en fonction de leur appartenance à leur groupe d’origine,
mais de leurs statut personnel (habeas corpus) il devient difficile à la
société moderne de se fermer sur elle-même.
Fustel de Coulanges
La Cité antique, 1864. Rome et Athènes, d’abord communautés stables et
fermées, puis individualistes et ouvertes...
Durkheim : solidarité
mécanique, solidarité organique
Dans De la division du travail social, Durkheim
distingue la solidarité mécanique (communautés réduites) de la solidarité
organique, dans le cadre de la division du travail (NB : chez Tönnies,
c’est plutôt la communauté qui est « organique » et la société
« mécanique » ...).
Dans la suite de son oeuvre (Les règles de la méthode
sociologique, Le suicide, Les formes élémentaires de la vie religieuse), il
montre le caractère quasi pathologique de la société « anomique »
(suicide, luttes économiques, insatisfaction résultant d’une existence
« anomique » (...).
CNote sur Durkheim et sa
thèse sur le suicide :
Le principe fondamental de la sociologie durkheimienne
est l’affirmation que l’objet de la science sociale est ailleurs que dans
l’étude de l’homme individuel, de ses actes, de son comportement, etc...;
qu’il existe en quelque sorte des phénomènes extérieurs aux individus que le
savant doit mettre à jour avant d’établir entre eux des rapports nécessaires,
c’est à dire des lois. Ce sont ces phénomènes que Durkheim appelle les faits
sociaux. Voici un exemple de fait social selon Durkheim : «chaque groupe social
a réellement [pour le suicide] un penchant collectif qui lui est propre et dont
les penchants individuels dérivent, loin qu’il procède de ces derniers ».
Ce penchant collectif peut être étudié, selon Durkheim, comme un phénomène,
bien qu’il ne se manifeste jamais à nous de façon directe. Seule la statistique
(qui joue un peu dans la sociologie de Durkheim le rôle de la lunette en
astronomie) permet de l’appréhender. Cette conception scientifique exclut le
recours à l’intuition, au psychologisme, à la «compréhension» qui, selon
Durkheim, visent à côté de l’objet sociologique.
Quant au mode d’existence des faits sociaux, Durkheim
refuse comme on le verra de s’en préoccuper, la question lui paraissant trop
métaphysique. Il dit expressément: « il faut traiter les faits sociaux
comme des choses»; il est en cela kantien et positiviste: il étudie des
phénomènes et non pas les noumènes, des objets construits et non pas le réel
chaotique et inintelligible. Sa démarche est donc à relier à celle qui
président dans les sciences de la nature : observation, mesure,
corrélations etc…
Dans «le Suicide» (1897), Durkheim met en œuvre les principes énoncés dans «Les règles de la
méthode sociologique». Il définit le suicide comme «tout cas de mort qui
résulte directement ou indirectement d’un acte positif ou négatif accompli par
la victime elle-même et qu’elle savait devoir produire ce résultat». Cet acte
qui semble totalement individuel puisque n’affectant que l’individu, parait
dépendre uniquement de facteurs psychologiques individuels, donc échapper à la
sociologie. Mais Durkheim montre qu’il peut être envisagé d’une façon tout à
fait différente : on peut considérer non plus l’acte individuel dans sa
singularité, mais l’ensemble des suicides commis dans une société donnée,
pendant un laps de temps donné. On remarque alors deux choses : le taux de
suicide possède un degré de constance égal sinon supérieur à celui de la
mortalité, mais en revanche on peut noter des différences significatives
suivant le pays considéré, chacun ayant un coefficient d’accélération qui lui
est propre. Cette permanence et cette variabilité démontrent que le suicide
est une tendance collective : «chaque société est prédisposée à fournir un
contingent déterminé de morts volontaires». C’est donc un fait social
extérieur à l’individu et coercitif qui, malgré son caractère d’exception, a
son invariabilité. Il peut être étudié par la sociologie.
Durkheim commence par démontrer qu’on ne peut en
rendre compte par des facteurs extra-sociaux, tels les états psychopathiques :
«les pays où il y a le moins de fous sont ceux où il y a le plus de suicides» ;
l’alcoolisme : «le groupe où l’on se suicide le plus [en Allemagne) est un de
ceux où l’on consomme le moins d’alcool» ; la race, l’hérédité n’influent
pas non plus : «comment attribuer à l’hérédité une tendance qui n’apparaît que
chez l’adulte et qui, à partir de ce moment prend toujours plus de force à
mesure que l’homme avance dans l’existence». Les facteurs cosmiques n’ont en
eux-mêmes aucun rôle, car, s’il est vrai que «les suicides sont plus nombreux
en été qu’en automne et en automne qu’en hiver», en revanche «on se suicide
plus dans le nord qu’au sud». En ce qui concerne l’imitation «s’il est certain
que le suicide est contagieux d’individu à individu, jamais on ne voit
l’imitation le propager de manière à affecter le taux social des suicides».
Il étudie ensuite les différents types de suicide et
leurs causes sociales. li distingue le suicide égoïste, le suicide altruiste et
le suicide anomique.
Le type égoïste, né de «cet état où le moi individuel
s’affirme avec excès en face du moi social et aux dépens de ce dernier», varie
en raison inverse du degré d’intégration de l’individu dans la société
religieuse, familiale ou politique. Prenons comme exemple l’influence de la
famille. Les statistiques font apparaître que les célibataires se suicident
plus que les gens mariés, les veufs ayant des enfants plus que les gens mariés,
mais en général moins que les célibataires.
Tableau 1 :
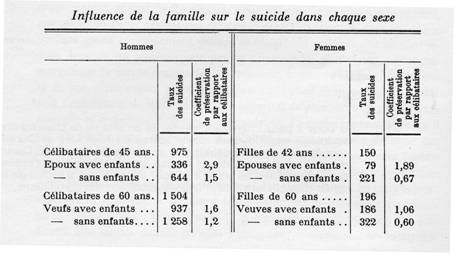
Le facteur essentiel de préservation n’est pas comme
on pourrait le croire le mariage lui-même, mais la famille. En effet comme le
montrent les tableaux ci-dessus et la carte ci-dessous, «à mesure que les
suicides diminuent, la densité familiale s’accroît régulièrement».
Carte 1 : corrélation entre suicides et densité
familiale
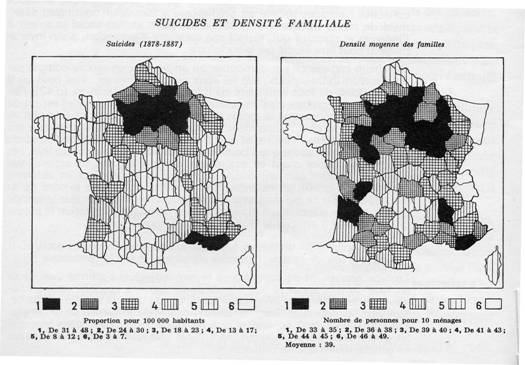
«La
région où les familles ont la moindre densité a sensiblement les mêmes limites
que la zone suicidogène. Elle occupe, elle aussi, le Nord et l’Est et s’étend
jusqu’à la Bretagne d’un côté, jusqu’à la Loire de l’autre. Au contraire, dans
l’Ouest et dans le Sud, où les suicides sont peu nombreux, la famille a
généralement un effectif élevé. Ce rapport se retrouve même dans certains
détails. Dans la région septentrionale, on remarque deux départements qui se
singularisent par leur médiocre aptitude au suicide, c’est le Nord et le
Pas-de-Calais, et le fait est d’autant plus surprenant que le Nord est très
industriel et que la grande industrie favorise le suicide. Or, la même
particularité se retrouve sur l’autre carte. Dans ces deux départements, la
densité familiale est élevée, tandis qu’elle est très basse dans tous les
départements voisins. Au sud, nous retrouvons sur les deux cartes la même tache
sombre formée par les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes Maritimes, et, à
l’ouest, la même tache claire formée par la Bretagne. Les irrégularités sont
l’exception et elles ne sont jamais bien sensibles; étant donné la multitude facteurs
qui peuvent affecter un phénomène de cette complexité, une coïncidence aussi
générale est significative.
La même relation inverse se retrouve dans la
manière dont ces deux phénomènes ont évolué dans le temps. Depuis 1826, le
suicide ne cesse de s’accroître et la natalité de diminuer. De 1821 à 1830,
elle était encore de 308 naissances par 10.000 habitants; elle n’était plus que
de 240 pendant la période 1881-88 et, dans l’intervalle, la décroissance a été
ininterrompue. En même temps, on constate une tendance de la famille à se fragmenter
et à se morceler de plus en plus. De 1856 à 1886, le nombre des ménages s’est
accru de 2 millions en chiffres ronds; il est passé, par une progression
régulière et continue, de 8.796.276 à 10.662.423. Et pourtant, pendant le même
intervalle de temps, la population n’a augmenté que de deux millions
d’individus. C’est donc que chaque famille compte un plus petit nombre de
membres.
Ainsi, les faits sont loin de confirmer la
conception courante, d’après laquelle le suicide serait dû surtout aux charges
de la vie, puisqu’il diminue au contraire à mesure que ces charges augmentent.
Voilà une conséquence du malthusianisme que ne prévoyait pas son inventeur.
Quand il recommandait de restreindre l’étendue des familles, c’était dans la
pensée que cette restriction était, au moins dans certains cas, nécessaire au
bien-être général. Or, en réalité, c’est si bien une source de mal-être,
qu’elle diminue chez l’homme le désir de vivre. Loin que les familles denses
soient une sorte de luxe dont on peut se passer et que le riche seul doive
s’offrir, c’est, au contraire, le pain quotidien sans lequel on ne peut
subsister. Si pauvre qu’on soit, et même au seul point de vue de l’intérêt
personnel, c’est le pire des placements que celui qui consiste à transformer en
capitaux une partie de sa descendance.
Ce résultat concorde avec celui auquel nous
étions précédemment arrivé. D’où vient, en effet, que la densité de la famille
ait sur le suicide cette influence ? On ne saurait, pour répondre à la
question, faire intervenir le seul facteur organique; car si la stérilité
absolue est surtout un produit de causes physiologiques, il n’en est pas de
même de la fécondité insuffisante qui est le plus souvent volontaire et qui
tient à un certain état de l’opinion. De plus, la densité familiale, telle que
nous l’avons évaluée, ne dépend pas exclusivement de la natalité; nous avons vu
que, là où les enfants sont peu nombreux, d’autres éléments peuvent en tenir lieu
et, inversement, que leur nombre peut rester sans effet s’ils ne participent
pas effectivement et avec suite à la vie du groupe. Aussi n’est-ce pas
davantage aux sentiments sui generis des parents pour leurs descendants
immédiats qu’il faut attribuer cette vertu préservatrice. Du reste, ces
sentiments eux-mêmes, pour être efficaces, supposent un certain état de la
société domestique. Ils ne peuvent être puissants si la famille est
désintégrée. C’est donc parce que la manière dont elle fonctionne varie suivant
qu’elle est plus ou moins dense, que le nombre des éléments dont elle est
composée affecte le penchant au suicide.
C’est
que, en effet, la densité d’un groupe ne peut pas s’abaisser sans que sa
vitalité diminue. Si les sentiments collectifs ont une énergie particulière,
c’est que la force avec laquelle chaque conscience individuelle les éprouve
retentit dans toutes les autres et réciproquement. L’intensité à laquelle ils
atteignent dépend donc du nombre des consciences qui les ressentent en commun.
Voilà pourquoi plus une foule est grande, plus les passions qui s’y déchaînent
sont susceptibles d’être violentes. Par conséquent, au sein d’une famille peu
nombreuse, les sentiments, les souvenirs communs ne peuvent pas être très
intenses; car il n’y a pas assez de consciences pour se les représenter et les
renforcer en les partageant. Il ne saurait s’y former de ces fortes traditions
qui servent de liens entre les membres d’un même groupe, qui leur survivent
même et rattachent les unes aux autres les générations successives. D’ailleurs,
de petites familles sont nécessairement éphémères; et, sans durée, il n’y a pas
de société qui puisse être consistante. Non seulement les états collectifs y
sont faibles, mais ils ne peuvent être nombreux; car leur nombre dépend de
l’activité avec laquelle les vues et les impressions s’échangent, circulent
d’un sujet à l’autre, et, d’autre part, cet échange lui-même est d’autant plus
rapide qu’il n’y a plus de gens pour y participer. Dans une société
suffisamment dense, cette circulation est ininterrompue; car il y a toujours
des unités sociales en contact, tandis que, si elles sont rares, leurs
relations ne peuvent être qu’intermittentes et il y a des moments où la vie
commune est suspendue. De même, quand la famille est peu étendue, il y a
toujours peu de parents ensemble; la vie domestique est donc languissante et il
y a des moments où le foyer est désert.
Mais dire d’un groupe qu’il a une moindre vie
commune qu’un autre, c’est dire aussi qu’il est moins fortement intégré; car
l’état d’intégration d’un agrégat social ne fait que refléter l’intensité de la
vie collective qui y circule. Il est d’autant plus un et d’autant plus
résistant que le commerce entre ses membres est plus actif et plus continu. La
conclusion à laquelle nous étions arrivé peut donc être complétée ainsi de même
que la famille est un puissant préservatif du suicide, elle en préserve
d’autant mieux qu’elle est plus fortement constituée.»
E. Durkheim, Le suicide, P.U.F., 1967, pp.
210-214.
Cf Nisbet p 123, les trois sortes de suicides selon Durkheim :
« Le suicide égoïste — Il se produit lorsque la cohésion des groupe~ auxquels
appartiennent les hommes décime au point de ne plut apporter au moi le soutien
qu’elle lui donne habituellement. L’unE des propositions les plus célèbres de
Durkheim est que le suicidE varie inversement au degré d’intégratjon des
groupes sociaux dont l’individu fait partie. Quand la société est fortement
intégrée, elle impose aux individus des contraintes, les considère à son
service et leur interdit donc de disposer d’eux-mêmes à leur gré. Au sein des
populations modernes où les liens associatifs sont relativement faibles, qu’il
s’agisse des protestants, des citadins, des travailleurs de l’industrie ou des
membres des professions libérales, les taux de suicide sont plus élevés que
dans des groupes de caractère opposé.
Le
suicide anomique — A la différence du
suicide égoïste, le suicide anomique est causé par la brusque dislocation des
systèmes normatifs, par l’effondrement des valeurs sur lesquelles une vie tout
entière à pu être fondée, ou par le conflit entre les buts recherchés et la
capacité de les atteindre. Ce n’est pas la pauvreté qui pousse au suicide.
Durkheim mentionne la remarquable immunité des pays pauvres au suicide: «Si la
pauvreté protège contre le suicide, c’est que, par elle-même, elle est un frein
(...). La richesse, au contraire, par les
pouvoirs qu’elle confère, nous donne l’ilusjon que nous ne relevons que de
nous-mêmes. En diminuant la résistance que nous opposent les choses, elle nous
induit à croire qu’elles peuvent être indéfiniment vaincues. Or, moins on se
sent limité, plus cette limitation paraît insupportable » En bref l’anomie est un effondrement de
la communauté morale tout comme l’égoïsme est un effondrement de la
communauté sociale.
Le
suicide altruiste — La troisième forme de
suicide ne résulte pas moins essentiellement du contexte social que les deux
précédentes, mais elle se manifeste lorsque l’individu est si engagé dans la
relation sociale qu’il en vient à se donner la mort parce qu’il croit que cette
relation sociale se trouve déshonnorée du fait d’un acte qu’il a commis.
L’essence d’un tel suicide, remarque Durkheim, n’est pas la fuite mais
l’auto-punition. Bien que ce type de suicide ait plus de chances de se produire
dans les sociétés primitives où le consensus tribal peut être tout puissant,
même s’il est rare, il se produit parfois également dans les secteurs de la
société moderne où la tradition règne en maître, comme par exemple les corps
d’officiers d’organisations militaires établies .
Pour
Durkheim « (..) chaque société humaine a pour le suicide une aptitude plus ou
moins prononcée : l’expression est fondée sur la nature des choses. Chaque
groupe social a réellement pour cet acte un penchant collectif qui lui est
propre et dont les penchants individuels dérivent, bien qu’il procède de ces
derniers. Ce qui le constitue, ce sont ces courants d’égoïsme, d’altruisme ou
d’anomie qui travaillent la société considérée, avec les tendances à la
mélancolie langoureuse ou au renoncement actif ou à la lassitude exaspérée qui
en sont les conséquences. Ce sont ces tendances de la collectivité qui, en
pénétrant les individus, les déterminent à se tuer. Quant aux événements privés
qui passent généralement pour être les causes prochaines du suicide, ils n’ont
d’autre action que celle que leur prêtent les dispositions morales de la
victime, écho de l’état moral de la société ».
Le suicide anomique se produit lorsque l’activité
sociale est brusquement déréglée. C’est ainsi que les crises économiques
s’accompagnent toujours d’une augmentation du nombre des suicides.
Paradoxalement, les crises de prospérité ont le même effet. Ce n’est donc pas
la paupérisation elle-même qui en est la cause, mais la perturbation de
l’activité sociale. Durkheim en donne comme preuve l’absence de corrélation
existant entre richesse et suicide. Au contraire, le suicide altruiste se
manifeste chaque fois que l’individu est trop fortement intégré à la société
(sociétés primitives, armée).
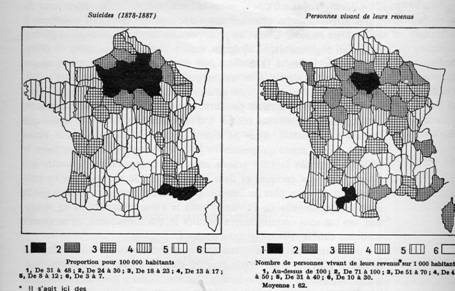
En conclusion, Durkheim montre que toutes les analyses
précédentes permettent de dégager avec certitude ce qu’il appelle «l’élément
social du suicide». Toutes les situations individuelles peuvent sembler être
la cause des suicides mais elles ne peuvent rendre compte du taux des suicides.
Le suicide considéré sous cet aspect est un fait social et ses causes sont
entièrement d’ordre social.
Par ailleurs, Durkheim critique la thèse du contrat
considéré comme modèle de toute relation sociale (Hobbes, Rousseau, les
Lumières, les Utilitaristes) : aucun type de contrat ne saurait durer s’il
ne reposait sur des conventions, des traditions, des codes dont l’ascendant est
plus fort que les obligations du contrat.
Georg Simmel :
communautés concentriques
Problèmes de la philosophie de l’histoire, 1892 ;
Sociologie de la religion ; Philosophie de l’argent, 1900 ;
Sociologie, 1908...
Simmel s’intéresse à la microsociologie : groupes
restreints (dyade, triade), liens sociaux (amitié, obéissance, loyauté...). Il
oppose les groupes concentriques (comme au moyen âge : famille, paroisse,
province, royaume, chrétienté) aux groupes intersécants (qui se croisent à
l’intérieur d’une même personne : les appartenances politiques ou
syndicales intersectent les appartenances familiales ou géographiques) ;
ces derniers favorisant la prise de conscience de l’individualité... L’argent
symbolise la transformation de valeurs qualitatives en valeurs quantitatives et
l’affranchissement des individus par rapport aux institutions communautaires...
Etude de la « société secrète », qui confère l’autonomie, et la
distinction (contre l’impersonnalité et l’hétérogénéité) ; elle permet
l’inclusion en même temps que l’exclusion...
Chapitre 4 : Autorité et pouvoir
1/ le spectre du pouvoir (139)
L’autorité est, en même temps que la communauté et la
tradition, caractéristique de la société d’ancien régime. Cf. Bonald, (Théorie
du pouvoir politique et religieux) : distinction (médiévale) entre sphères
d’autorité (famille, corporation, Église, stat). Le bouleversement de la
société traditionnelle par les « deux révolutions » entraîne la
constitution d’un pouvoir politique fort, centralisé, rationalisé, et d’assise
populaire.
F Ainsi Tocqueville redoute-t-il que la disparition des
anciens pouvoirs ne soit le prélude à la constitution de pouvoir plus
fort, des pouvoir de masse « dont l’emprise serait plus profonde et
plus étendue que jamais » (Nisbet p 140)
Dans cet ordre ancien, l’image du pouvoir monarchique
n’est guère différente de l’image du patriarche dans la communauté. « le
pouvoir monarchique a tellement tendance à être noyé dans l’éthique patriarcale
qu’il ne semble guère différent de celui dont jouit le père sur ses fils, le
prêtre sur ses fidèles, le maître sur ses apprentis. » (140)
« On se demande alors d’où pourra émaner une
autorité suffisamment forte pour remplacer l’autorité disparue et mettre un
frein à l’anarchie qui tend naturellement à s’infiltrer dans les sociétés civilisées
par les brèches ouvertes dans le droit et la morale. Quelle sera la nature de
cette autorité ? » 140)
4 aspects de l’ordre révolutionnaire puis napoléonien,
selon la tradition sociologique (141)
1.1 – le totalitarisme du pouvoir révolutionnaire
(141)
Robespierre
« : « despotisme de la liberté contre la tyrannie » >
« pas de liberté pour les ennemis de la liberté » > totalitarisme
soviétique : la dictature du parti.
1.2 – le pouvoir révolutionnaire repose sur les masses
(142)
«
le peuple souverain » l’homme de la révolution défini comme citoyen, en
tant qu’il appartient au peuple. (substitution du « citoyen » au
« monsieur » )
1.3 – la centralisation du pouvoir révolutionnaire
(142)
Dans la continuité de la formation de l’unité de la
nation sous l’ancien régime, on passe chez les révolutionnaires à l’idée d’une
société pyramidale, dont la base et le peuple, mais qui concentre finalement
dans les mains de quelques décideurs, voire d’un seul l’ensemble des pouvoir.
(on passe de l’assemblée des représentant à l’idée d’un directoire, puis de 3
consuls, puis à l’Empire Napoléonien.)
1.4 – la rationalisation du pouvoir (143)Volonté d’une
rationalisation généralisée de la société : le système métrique, les
départements, centralisation de l’enseignement, le modèle militaire etc…
F« Le personnage-clé de la Révolution n’est ainsi ni l’homo economicus,
ni l’homo religiosus, ni l’home ethicus, mais l’homo politicus. D’où
l’exaltation du citoyen. » (Nisbet) « ... l’école
révolutionnaire a seule compris que le développement continu de l’anarchie
intellectuelle et morale exigeait, de toute nécessité, pour prévenir une
imminente dislocation générale, une concentration croissante de l’action
politique proprement dite. » (Comte, Cours de philosophie politique).
2/ Autorité et
pouvoir (144)
Sens de cette distinction : l’autorité semble un
concept du passé, faire référence à l’ancien régime, ou mieux encore, à la
société médiévale. Le concept de pouvoir lui, fait référence au pouvoir
politique tel qu’il s’installe après la révolution moderne au sein d’un état de
droit. D’un côté on est dans un « distributisme politique »
(distribution et décentralisation des centre d’autorité) ; de l’autre le
« centralisme rationnel » (pouvoir démocratique centralisateur,
rationnel)
La distinction autorité / pouvoir est également
reprise par un courant du libéralisme social, en particulier Lamennais, qui
soutient la liberté d’association contre l’emprise de l’Etat. Cf. aussi
Tocqueville (la décentralisation administrative et les associations en
Amérique).
Noter aussi chez Bodin (1576) : distinction entre
l’autorité conditionnelle et limitée de la société (monastère, commune,
corporation), et l’autorité souveraine de l’Etat ; distinction reprise par
Hobbes (qui compare les associations à des « vers dans les entrailles de
l’homme naturel » ), les philosophies du droit naturel, Rousseau...
Dans l’autorité sociale, approche
phénoménologique et morale (cf Burke « Nul n’a jamais été lié par un
sentiment de fierté, de prédilection ou de véritable affection à une
description de surfaces géométriques. (…) c’est au sein de la famille que
naissent les affections politiques (…) Puis elle s’étendent au voisinage et à
ceux que nous avons coutume de rencontrer dans notre province ».
Dans le pouvoir politique, l’approche est
rationnelle –cf la définition du contrat social de Rousseau : « trouver
une forme d’association qui défende et protège de toute la force commune la
personne et les biens de chaque associé, et où chacun s’unissant à tous
n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre qu’auparavant. Développer
les termes du problème et la solution rationnelle, -unanimité, exhaustivité,
réciprocité des droits et des devoirs)- avec ses conséquences aporistiques)
–contradiction entre volonté individuelle –« on les contraindra de
toute la force publique, ce qui ne veut pas dire autre chose qu’on les obligera
à être libres (Rousseau)» ou encore la contradiction entre les
principes d’égalité et de liberté, dans la vie sociale, tempérée il est vrai
par le terme de fraternité.
Ffaire remarquer à propos de cette dernière distinction
la rupture au sein de la devise de la République : comment faire
fonctionner réellement ce qui est une affirmation théorique ; cette
contradiction est au sein de la constitution fondamentale des nations
démocratiques.
« 149 « l’aversion des philosophes français
des lumières pour l’autorité traditionnelle va de pair avec leur aversion pour
la communauté traditionnelle : il s’agit là des deux facettes d’une même
philosophie » (149)
F conclusion : dernier paragraphe de cette partie p 150 (et
commenter)
Le
résultat de deux siècles de réflexion sur le concept de souveraineté avait
donc été de faire apparaître pouvoir politique d’une part, tradition morale et
autorité sociale de l’autre, comme deux choses indépendantes l’une de l’autre,
voire antithétiques. De Hobbes à Rousseau les philosophes avaient affirmé que
l’origine de la véritable souveraineté ne réside ni dans la tradition ni dans
les autorités sociales historiques, mais dans la nature humaine et le
consentement contractuel, que celui-ci soit réel ou implicite. La majesté et la
rationalité de la souveraineté provenaient précisément à leurs yeux de son
autonomie par rapport aux autres types d’autorité.
C’est
dans ce contexte qu’apparaît le mieux le sens des théories sociologiques qui
voient le jour au XIXe siècle. La redécouverte de la communauté va en effet de
pair avec une redécouverte de la coutume, de la tradition et de l’autorité
patriarcale ou corporative, où les sociologues de cette époque voient les
fondements permanents du pouvoir social et politique. Dans cette perspective
l’Etat devient une autorité parmi d’autres qui la conditionnent, la
circonscrivent et la limitent,’et c’est ce qui explique que les sociologues
récusent l’approche abstraite ou formelle de la nature de la souveraineté. Le
pluralisme politique apparaît ainsi participer d’un système philosophique au
même titre que le syndicalisme, le socialisme ~mutualiste et toutes les autres
idées décentralisatrices. Du point de vue historique il existe donc un rapport
étroit entre ces thèmes et la naissance de la sociologie.
3/ La
découverte des élites. (150)
La contestation des
autorités traditionnelles
(165 F
lire et commenter) Du rejet des traditions intellectuelles (Descartes) à celui
des traditions politiques... Le rejet de toutes les traditions qui, chez
Descartes, était d’ordre épistémologique et permettait d’établir les bases de
la vérité pure à partir de la seule raison, fournit une « méthode »
tout à fait adaptée à une théorie du gouvernement qui cherche, au nom de la
liberté et de l’égalité, à récuser les autorités et les dogmes traditionnels.
Une telle méthode renforce du reste la puissance de l’opinion publique
puisqu’elle fait du bon sens de chaque individu (qui, comme Descartes lui-même
l’avait noté, est la chose du monde la mieux partagée...), un guide lui
permettant de venir à bout de toutes les difficultés et de tous les mystères.
5/ Marx et l’utilisation du pouvoir (168) opposition
de Marx et de Tocqueville.
-
quelle
est l’origine du pouvoir (reprendre l’analyse du matérialisme historique)
-
De
le disparition du pouvoir.
-
Opposition
Marx Tocqueville p. 170 F
lire le passage surligné)
-
6/Weber et la
rationalisation de l’autorité
Max
Weber distingue trois sources d’autorité (180) :
![]() la
domination traditionnelle,
la
domination traditionnelle,
![]() la
domination rationnelle ou légale (règles, bureaucratie...), caractéristique des
démocraties modernes,
la
domination rationnelle ou légale (règles, bureaucratie...), caractéristique des
démocraties modernes,
![]() la
domination charismatique (le « grand homme », le
« prophète » ), révolutionnaire et instable.
la
domination charismatique (le « grand homme », le
« prophète » ), révolutionnaire et instable.
Pour Weber, le processus de
rationalisation-bureaucratisation de l’autorité est amorcé en fait dès le haut moyen-âge. Contrairement à Marx, il pense que
la propriété des moyens de production et la division entre travailleurs et
propriétaires n’a qu’une influence secondaire : il n’y aura donc pas - du
point de vue de l’exercice du pouvoir - de différence essentielle entre les
sociétés capitalistes et socialistes.
Durkheim : le triangle
des forces
« Pour Bentham, la morale, comme la législation,
consistait dans une sorte de pathologie. La plupart des économistes orthodoxes
n’ont pas tenu un autre langage. Et c’est sans doute sous l’influence du même
sentiment que, depuis Saint-Simon, les plus grands théoriciens du socialisme
ont admis comme possible et désirable une société d’où toute réglementation
serait exclue. L’idée d’une autorité, supérieure à la vie et qui lui fasse la
loi, leur paraît être une survivance du passé, un préjugé qui ne saurait se
maintenir. » (L’Éducation morale) « ... on peut dire que,
contrairement aux apparences, ces mots de liberté et d’irréglementation jurent
d’être accouplés, car la liberté est le fruit de la réglementation. C’est sous
l’action, c’est par la pratique des règles morales que nous acquérons le
pouvoir de nous maîtriser et de nous régler, qui est tout le réel de la
liberté. » (Leçons de sociologie, Physique des moeurs et du droit)
« C’est seulement lorsque l’individu est
fermement soumis à toute une série d’autorités, tant sociales que morales, que
la liberté politique devient possible. » (cf. aussi Montesquieu, la vertu
comme principe de la démocratie) L’Etat absorbe les fonctions remplies
autrefois par d’autres instances « dont il ne se saisit qu’en les
violentant » (Durkheim) d’où la croissance de sa bureaucratie...
L’Etat et les groupes intermédiaires :
« Point de groupes secondaires, point d’autorité politique, du moins point
d’autorité qui puisse, sans impropriété, être appelée de ce nom. »
(Durkheim, Leçons de sociologie).
Le triangle de forces : l’individu, l’État, les
groupes (intermédiaires). L’Etat protège l’individu contre l’oppression des
groupes (à travers les droits) les groupes le protègent contre l’oppression de
l’Etat. Affinité entre l’Etat et l’individu (dès l’Antiquité)
Simmel : les trois
formes de l’autorité
Autorité et liberté : la persécution de la
société secrète accentue le sentiment de liberté interne de ses membres, en
dépit de l’autorité de fer à laquelle ils sont soumis. Simmel traite de
l’autorité dans « Domination et subordination », en distinguant trois
formes : « centralisation individuelle », « subordination à
une pluralité », « subordination à une principe » L’autorité
exercée sur les personnes « présuppose... la liberté des
personnes... » (Simmel) La réciprocité comme essence de l’autorité
personnelle : lorsque le groupe s’étend, elle diminue, au profit de la
domination pure et simple (le groupe « dispose » de ses
membres) : « c’est l’absence de réciprocité qui explique que la
tyrannie du groupe sur ses membres soit pire que celle du prince sur ses
sujet. »
La centralisation de l’autorité dans un
individu : « Ainsi c’est à la centralisation que le judaïsme comme le
christianisme doivent d’avoir réussi à arracher les individus à leur loyautés
tribales ou familiales pour les soumettre à l’autorité divine. » (Nisbet).
La subordination à une pluralité : la
« république », pouvoir majoritaire, objectif, impersonnel.
La subordination à un principe : subordination à
des « objets » (la terre, la machine...), « une forme de
subordination sévère, humiliante et inconditionnelle car, dans la mesure où
l’homme est subordonné en vertu de son appartenance à un objet, il tombe lui
même psychologiquement dans la catégorie des simples objets. » (Simmel,
ibid)
Chapitre
5 : Statut et classe
L’individualisation de la stratification sociale donne
au statut l’ascendant sur la classe - « le statut étant à la fois plus mobile,
plus individuel et plus diversifié que la classe. »
« Le terme de statut désigne la position de
l’individu dans la hiérarchie de prestige et d’influence qui caractérise toute
communauté ou association ». (p. 19)
« Ce que la sociologie oppose au concept de
statut ce n’est pas la notion populaire d’égalité, mais le concept de classe,
qui est à la fois plus récent et plus complexe, et qui recouvre une réalité à
la fois plus étroite et plus collective. » (p. 19)
Le concept de classe sociale fait une apparition
tardive : il désigne une représentation de la société comme stratifiée, en
« couches » indépendantes les unes des autres et définies par une
communauté de besoins, d’intérêt, et de valeurs.
La notion de hiérarchie sociale est présente dans
l’histoire de la pensée de l’antiquité au XIXème siècle : elle indique une
volonté de définir des niveaux, souvent des degrés de dignité, dans la société.
Le concept de classe n’apparaîtra pas avant la fin du
XVIIIème siècle. Il apparaît tout
d’abord pour désigner la « classe des propriétaires fonciers » en
Grande Bretagne. La notion de classe, telle qu’on peut l’observer dans la
société libérale du XIX sera dérivée de cette idée. « fonction conceptuelle de
cette classe, qui en vient à fournir le modèle de ce qui constitue la substance
de toute classe » (p. 223)
« Ce qui la définissait, c’était en premier lieu
son unité économique qui reposait largement sur la propriété foncière. »
(marque d’une certaine réussite sociale)
Cette classe se définit également par son unité politique, les membres
de cette classe concentrant entre leurs mains un pouvoir politique et
administratif, même sur le plan local. Cette classe n’était pas fermée sur elle
même en droit, mais dans les faits, l’accès à cette classe était relativement
difficile. . Elle se distinguait enfin par une identité culturelle, possédant
ses propres écoles, et son mode d’être (genleman) ; elle imposait un style
de référence.
Par la suite, le concept de classe va servir d’outil à
une analyse de la stratification sociale. (P. 227) : [les sociologues]
« cherchaient même à découvrir, dans les nouvelles strates
socio-économiques apparues avec le capitalisme, une convergence d’éléments
politiques, économiques et culturels identiques à celle qui était si nette dans
l’aristocratie et la paysannerie pré-capitalistes. »
La controverse entre Marx et Tocqueville :
« la controverse n’est pas, en ce domaine, du
moins pour les sociologues, entre classes sociales et égalitarisme. Plus
subtile, et aussi plus fondamentale du point de vue théorique, elle oppose les
notions de classe sociale et de statut social, c’est à dire une conception
selon laquelle le nouvel ordre social reposerait sur l’existence de classes
sociales stables et bien définies à une autre conception, fondée elle sur
l’idée de l’érosion des classes sociales et de leur remplacement par des
groupes de statut fluctuants et mobiles et par des individu à la recherche d’un
statut. » (p. 227)
La nouvelle société (industrielle, centralisatrice,
égalitariste etc… -bref la société post démocratique et post industrielle)
« serait-elle organisée sur la base de couches sociales qui réaliseraient
la même unité économique, intellectuelle, culturelle et politique que les
anciens « rangs » ? » (classe des propriétaires fonciers) « Ou
bien la modernité aurait-elle un effet aussi corrosif sur les fondements des
classes sociales que sur la communauté villageoise, la famille élargie, et
l’ensemble du réseau de relations morales et culturelles dont l’origine, comme
celle des classes sociales, remontait à
une époque pré-capitaliste, pré-démocratique, et pré-rationaliste ? »
(228)
A ces questions, on peut apporter deux réponses
antagonistes : celle de Marx et celle de Tocqueville :
-
Pour Marx : La bourgeoisie, en tant que classe dominante, se construit sur
le modèle de la classe des propriétaires fonciers. Elle réunit entre ses mains
le pouvoir économique, politique et culturel, et impose sa culture dominante
aux autres classes, en particulier la classe ouvrière. Celle-ci doit à son tour
s’identifier comme classe, opposée à la première, et constituer sa « conscience de
classe » : identité d’intérêt, poids du travail dans le rapport de
force qui l’oppose à la bourgeoisie, valeurs propres de la culture ouvrière.
-
Pour Tocqueville : Dans la pensée libérale, la notion de classe est vouée
à disparaître, pour faire apparaître la notion de statut individuel :
éclatement de l’union « séculaire entre richesse pourvoir et
statut », individualisation de la stratification, primauté du statut sur la
classe. Vision idéale d’un libéralisme permettant à tous de réussir, quelque
soit son origine et sa dépendance de classe.
Cependant l’opposition des réponses que nous venons
d’évoquer, ne recouvre que partiellement la distinction politique entre
conservateurs et radicaux.
« Ces deux positions idéologiques (Marx et
Tocqueville) constituent en quelque sorte les pôles magnétiques autour desquels
s’organisa toute la réflexion sur la stratification sociale au XIXème
siècle. »
Nisbet pense qu’aujourd’hui l’interprétation de
Tocqueville a pris l’ascendant sur l’interprétation Marxienne.
Tocqueville : le
triomphe du statut
Tocqueville fut le premier auteur... à exposer l’idée
que ce qui caractérise le régime moderne ce n’est pas la consolidation mais au
contraire l’éclatement de la structure de classes et la dispersion de ses
éléments fondamentaux - le pouvoir passant aux mains des masses et de la
bureaucratie centralisée, la richesse à une classe moyenne de plus en plus
nombreuse et le statut aux différents secteurs mouvants de la société qui, en
l’absence d’ue véritable structure de classes, deviennent le théâtre de
douloureuses et interminables luttes entre les individus cherchant à acquérir
les marques du statut.
Le comportement des Américains à l’égard des Noirs...
Tocqueville pose le problème des Noirs en termes de statut et de relation de
statut, non en termes de race ou de minorité. Il constate que le préjugé de
race est plus fort au Nord que dans les Etats esclavagistes...
Simmel :
l’autonomisation et objectivation du statut
Dans la société moderne, le statut tend à devenir
autonome par rapport aux fonctions sociales et indépendant des qualités
personnelles de celui qui en est investi... Grâce à l’objectivation, les
différents postes, situations ou rangs (statuts) peuvent être occupés par des
individus d’origine diverse.
Chapitre
6 : Sacré et profane
Sacré :
tout ce qui, dans la motivation individuelle comme dans l’organisation sociale,
transcende l’utilitaire ou le rationnel et tire sa force de ce que Weber
appelle le charisme et Simmel la piété. L’accent est mis sur cette notion dans
l’oeuvre de Tocqueville (relation entre le dogme et l’intellect), Fustel de
Coulanges (grandeur et décadence de la cité antique), Weber (autorité), Simmel
(piété), Durkheim (profane/sacré), Lamennais, Essai sur l’indifférence. Déjà,
chez Hegel (Philosophie du droit) : le religieux comme « cercle
d’association », notion capitale à ses yeux. La distinction du sacré
(principe transcendant, qui définit pour le religieux le fondement de l’être)
de du profane (le monde où l’on naît, vit, aime, travaille et meurt) est
fondamentale en sociologie.
Lecture de LE SACRE ET LE
LAIQUE, in Rober A. Nisbet, La
tradition sociologique, pp. 281-288.
A/
§1 : la religion n’est
pas pour les sociologues une pure illusion : elle se définit au moins par
ses fonctions sociales.
§ 2 : La religion, loin
d’être conçue comme obscurantisme comme le pensaient les philosophes des
lumières, se définit comme fonction sociale.
§ 3 : Cette
reconnaissance du fait religieux est faite par des sociologues, qui sur le plan
personnel, ne peuvent être qualifiés de croyants. C’est la fonction de la
religion dans la société qui les intéresse.
§4 : Cet intérêt que les
sociologues portent à la religion va de pair avec le regain d’intérêt qu’on lui
porte en littérature et en philosophie.
§ 5 : Témoignent de cet
intérêt la richesse et le nombre des ouvrages consacrés au christianisme ou à
la question religieuse tout au long du XIXème siècle, à la fois pour la louer
et la comprendre.
§ 6 Tous ces ouvrages,
quelque soient les tendances et l’appartenance de leurs auteurs, s’accordent
sur l’universalité du fait religieux.
§7 Ainsi, Hegel, bien que
rationaliste, accorde un rôle déterminant aux religions dans la sociabilité et
dans la formation de la pensée. Elle constitue une structure sociale autonome.
B/
§8 Comte, pour sa part, est
convaincu de l’utilité d’une puissance spirituelle capable de s’opposer aux
excès du temporel. Sa pensée personnelle, qui s’appuie sur une connaissance de
l’histoire médiévale, témoigne de
l’importance que le religieux revêt pour lui.
§9 Pour Comte enfin, la
religion est une nécessité pour les sociétés humaines ; le positivisme
remplacera le christianisme, mais lui empruntera ses rituels et ses pratiques
cultuelles.
§ 10 Mais il ne fait pas que
prendre la place du prêtre ou du prophète ; Comte relève les liens entre
le credo du religieux et la formation des citoyens, entre la célébration du
sacré et la socialisation des personnes. Comte est donc, en dépit qu’il en ait,
convaincu comme d’autres de la nécessité du lien religion-société ;
C/
§11 On peut aussi envisager
ce mouvement du côté des penseurs croyants. On en dégagera 4 points de
vue :
§12 En premier lieu il s’agit
de rappeler que la religion est au fondement et à la pérennité des valeurs
morales. Les théories du contrat, ou la morale laïque reposant sur des
impératifs catégoriques font pâle figure face au caractère transcendant des
fondements de la morale chrétienne.
§13 En second lieu ils insistent
sur le rôle de coercition idéologique que joue le christianisme : de là
une critique du protestantisme, qui accorde moins d’importance au rituel
collectif qu’à la pratique individuelle de la foi. Delà la ruine des valeurs
dans la société moderne.
§ 14 en troisième lieu on
insistera sur la hiérarchie ecclésiale
comme modèle de l’ordre social. On insistera aussi sur le caractère ésotérique
du dogme renforcé par la pompe liturgique, celle des rites et des sacrements.
§15 en quatrième lieu, les
conservateurs voient dans la révélation l’origine des catégories
intellectuelles du langage ; les idées, les pratiques, la fidélité des
engagements ont leur archétype dans leur origine sacrée, et non dans
l’arbitraire de la subjectivité.
§16
Proposition de corrigé :
Philosophes
et sociologues définissent la religion par sa fonction dans la cité. Croyants
ou non, tous lui reconnaissent ce rôle, qu’ils se proposent d’étudier. Comme
les écrivains, ils reconnaissent unanimement l’universalité du fait religieux,
même les rationalistes, tel Hegel, qui lui accordent un rôle déterminant dans
la /50 formation de la pensée et de la civilisation.
Comte,
s’appuyant sur sa connaissance de l’histoire médiévale, voit dans la religion
un contrepoids aux excès du pouvoir temporel, aristocratique ou royal. Quand le
positivisme remplacera le christianisme, il lui empruntera ses
célébrations : Comte reconnaît le lien que crée un /100 même credo, et le rôle de la religion dans la
formation des personnelle des citoyens.
Pour
les penseurs chrétiens, le renouveau religieux revêt quatre aspects. Constatant
l’échec des morales fondées sur des impératifs catégoriques, ils réaffirment
leur foi comme fondement éthique de valeurs pérennes ; a l’encontre du
protestantisme /150 qui accorderait trop d’importance à la
pratique religieuse individuelle, ils professent le pouvoir coercitif des
rituels ; le pouvoir ecclésial, détenteur de la vérité dogmatique des
mystères, offrirait le modèle d’un ordre social puissamment hiérarchisé ;
sur le plan intellectuel, les conservateurs voient dans la révélation, et non
dans l’/200 arbitraire
subjectif, l’archétype des catégories
intellectuelles. Cette conception du
sacré va devenir l’instrument d’analyse des sociologues. /219
M. Le Guen
Proposition de corrigé à
partir d’une bonne copie d’élève :
« Les
sociologues jugent la religion nécessaire à toute société. Ils s’opposent en
cela aux philosophes des lumières, au rationalisme individuel. Ce jugement
n’implique pas la foi personnelle du
sociologue et caractérise l’intérêt nouveau porté à la religion par les hommes
du XIXème siècle ; c’est un triple /50 intérêt philosophique
humaniste, littéraire.
Hegel
inclut la religion dans les relations sociales où elle constitue un cercle
d’associations tandis que Comte va jusqu’à faire remonter l’éclatement de la
société moderne à la Réforme brisant l’unité du christianisme. Ce dernier
estime que le positivisme remplacera le christianisme /100 comme base des relations humaines.
Les
ouvrages religieux de l’époque expliquent que les relations rationnelles d’une
société ne tiennent que par les inspirations religieuses qui s’y expriment.
D’autre part, la religion permet de comprendre l’histoire et les
bouleversements sociaux tels que ceux induits par l’/150 avènement
du protestantisme. Les auteurs assimilent la religion à une communauté et une
autorité imposant des devoirs, accordant des droits et ayant ses rites propres.
Grâce à cela, l’individu se sent protégé et inclus dans la société. Enfin, les
conservateurs posent la religion comme base des idées et des /200
croyances humaines. Ces différentes analyses servent à comprendre la religion.
/210»
Les Lumières réduisent la religion à la
superstition : Voltaire (Dictionnaire philosophique), d’Helvétius (De
l’homme), La Mettrie (L’Homme-machine), Condorcet (Esquisse d’un tableau des
progrès de l’esprit humain), d’Holbach (Système de la nature).
Pour les « philosophes », la religion n’est
pas une force qui émane de la nature même de l’âme ou de la société, mais un
ensemble de propositons intellectuelles portant sur l’univers et sur l’homme.
Marx : « la misère religieuse est tout à la fois l’expression de la
misère réelle et la protestation contre la misère réelle. La religion est le
soupir de la créature tourmentée, l’âme d’un monde sans coeur, de même qu’elle
est l’esprit de situations dépourvues d’esprit. Elle est l’opium du
peuple. » (Contribution à la critique de la philosophie du droit de
Hegel).
La pérennité du religieux
« Il y a donc (..) dans la religion quelque chose
d’éternel qui est destiné à survivre à tous les symboles particuliers dans
lesquels la pensée religieuse s’est successivement enveloppée. Il ne peut pas y
avoir de société qui ne sente le besoin d’entretenir et de raffermir, à
intervalles réguliers, les sentiments collectifs et les idées collectives qui
font son unité et sa personnalité. (Durkheim, Les formes élémentaires de la vie
religieuse).
Quatre idées fondamentales sur les fonctions du sacré
![]() religion
comme mécanisme indispensable à l’intégration des êtres humains ;
religion
comme mécanisme indispensable à l’intégration des êtres humains ;
![]() fondamental
pour la compréhension de l’histoire et du changement social. Pour Bonald,
Lamennais, Balmes, le protestantisme, parce qu’il met l’accent sur la foi
individuelle et qu’il fait peu de cas du rituel et de la liturgie a été une
force destructrice dans l’histoire européenne. Pour Lamennais, il est
responsable de l’« indifférence » moderne ; pour Chateaubriand
du déclin des valeurs culturelles ; pour Balmes du développement du
commerce et du despotisme politique moderne, pour Weber de l’« esprit du
capitalisme » ...
fondamental
pour la compréhension de l’histoire et du changement social. Pour Bonald,
Lamennais, Balmes, le protestantisme, parce qu’il met l’accent sur la foi
individuelle et qu’il fait peu de cas du rituel et de la liturgie a été une
force destructrice dans l’histoire européenne. Pour Lamennais, il est
responsable de l’« indifférence » moderne ; pour Chateaubriand
du déclin des valeurs culturelles ; pour Balmes du développement du
commerce et du despotisme politique moderne, pour Weber de l’« esprit du
capitalisme » ...
![]() la
religion : non seulement une foi, une doctrine, mais aussi une communauté,
une autorité, des rites...
la
religion : non seulement une foi, une doctrine, mais aussi une communauté,
une autorité, des rites...
![]() le
pouvoir qu’a la religion de stimuler, de renforcer, de protéger les individus ...
le
pouvoir qu’a la religion de stimuler, de renforcer, de protéger les individus ...
Tocqueville : ou des
croyances ou un maître...
Aux Etats-Unis, les catholiques sont encore plus
égalitaires et « démocratiques » que les protestants... Ce qui,
d’après Tocq., résulte de la nature même de la théologie catholique :
« le prêtre s’élève seul au-dessus de ses fidèles : tout est égal au
dessous de lui... » (Tocq.) Le protestantisme tend à rendre les hommes
indépendants plutôt qu’égaux...
La nécessaire séparation du politique et du religieux,
pour ne pas que se rejoignent ces deux types de passions...
Fustel de Coulanges :
le sacré comme angle d’approche
Fustel donne à la religion la même primauté
explicative que Marx à la propriété, Maine au droit et Buckle à l’environnement
physique.
La naissance du rationalisme (critique) grec homologue
des Lumières ; les pré-socratiques, constatant que les dieux ne peuvent
être considérés comme la cause efficace des phénomènes physiques en cherchent
l’origine dans les quatre éléments... Puis les sophistes : « ils ne
ménagèrent pas plus les institutions de la cité que les préjugés de la
religion... » (Fustel) ; doute, libre-examen...
Conclusion de La Cité antique : « Nous avons
fait l’histoire d’une croyance. Elle s’établit : la société humaine se
constitue. Elle se modifie : la société traverse une série de révolutions.
Elle disparaît : la société change de face. Telle a été la loi des temps
antiques. »
Durkheim (élève de Fustel de Coulanges) : le
sacré et le profane. Comme Tocqueville, Durkheim affirme que la religion est à
l’origine non seulement des idées fondamentales de l’homme, mais du cadre même
dans lequel fonctionne son esprit : « Si la philosophie et les
sciences sont nées de la religion, c’est que la religion elle-même a commencé
par tenir lieu de science et de philosophie. » (Les formes élémentaires...)
La puissance du contrat vient aussi, à l’origine, de
ce qu’il est sacré... Le verbe, le langage, le serment comme invocation d’un
être divin. « Le formalisme juridique n’est qu’un succédané du formalisme
religieux. » (Leçons de sociologie). Religieux et propriété - à travers la
« religiosité diffuse dans les choses » .
Pas de religion sans Église. « Une société dont
les membres sont unis parce qu’ils se représentent de la même manière le monde
sacré et ses rapports avec le monde profane, et parce qu’ils traduisent cette
représentation commune dans des pratiques identiques, c’est ce qu’on appelle
une Eglise » (Les formes élémentaires...)
Pour les croyants, l’essentiel ce n’est pas ce que la
religion dit sur les choses, « mais ce qu’elle fait pour rendre l’action
possible et la vie supportable. » (Nisbet). Le culte est
fondamental : c’est lui qui « suscite ces impressions de joie, de
paix intérieure, de sérénité, d’enthousiasme... » (Les formes
élémentaires..). Le culte : se libérer de la contamination du profane pour
accéder au sacré (d’où : mortification, renoncement, ascétisme...)
Les jours ordinaires (profanes), ce sont les tendances
utilitaires, individualistes et même antagonistes qui dominent. Les jours de
fête (religieuse) c’est les choses sociales... L’âme individuelle se
régénère...
Outre le sacrifice et l’imitation, il existe deux
autres types de rites, « représentatifs » (à l’origine de la
représentation théâtrale, quand la « culture » s’autonomise : du
« mystère » au théâtre ; aussi la tragédie grecque...) et
« piaculaires » (rites associés à la notion de malaise, de
pessimisme, d’appréhension... piaculum veut dire expiation : se laver de
ses péchés...)
Sacré : faste/néfaste : euphorie/dysphorie
collective.
Weber : le charisme et
la profession (Beruf)
Importance des études de Weber sur la religion :
Antiquité, Asie, Proche-Orient, Europe médiévale et moderne... Il renverse la
proposition marxienne : chaque type de société reflète un type de
religion...
Définition du charisme : « Nous appelons
charisme la qualité extraordinaire (à l’origine déterminée de façon magique
tant chez les prophètes et les sages, thérapeutes et juristes, que chez les
chefs des peuples chasseurs et les héros guerriers) d’un personnage qui est,
pour ainsi dire, doué de forces ou de caractères surnaturels ou surhumains ou
tout au moins en dehors de la vie quotidienne, inaccessibles au commun des
mortels ; ou encore qui est considéré comme envoyé par Dieu ou comme un
exemple, et en conséquence considéré comme un « chef » . »
(Économie et société).
« L’événement décisif dans notre reconnaissance
du charisme, c’est l’ampleur et la profondeur de son acceptation par les
adeptes de l’individu en question. Nous identifions le charisme de Jésus ou de
César non grâce à ce qu’ils ont fait ou dit réellement mais grâce au caractère
supra-rationnel et supra-utilitaire de l’attachement que leur vouaient leurs
adeptes. » (Nisbet)
Routinisation du charisme, « charisme
héréditaire » : acquisition légitime du charisme en vertu de l’ordre
héréditaire, le charisme personnel pouvant alors faire entièrement défaut...
Napoléon : charisme et bureaucratie. Légitimité
démocratique : le charisme (des institutions) conséquence et non cause de
la reconnaissance de légitimité. « L’un des éléments fondamentaux de
l’esprit du capitalisme moderne, et non seulement de celui-ci, mais de la
civilisation moderne elle-même, à savoir, la conduite rationnelle fondée sur
l’idée de Beruf, est né de l’ascétisme chrétien » . (L’Éthique
protestante...)
Simmel : la fonction de
la piété
« La relation de l’enfant dévoué à ses parents,
du fervent patriote à sa patrie ou du cosmopolite enthousiaste à l’humanité, la
relation de l’ouvrier à sa classe... ou du noble conscient de son rang à
l’aristocratie, la relation du vaincu au conquérant ou du bon soldat à son
armée, toutes ces relations, dont le contenu est infiniment varié, on un sens
général pour ce qui est de leur aspect psychologique, sens que l’on doit
appeler religieux. » (Simmel, Sociologie de la religion).
La piété - envers l’homme comme envers Dieu -
« religiosité à l’état presque fluide »,« émotion de l’âme qui
se transforme en religion toutes les fois qu’elle se projette dans des formes
spécifiques. » (Simmel, ibid). V. l’aliénation (en rapport avec le
« progrès »
Chapitre
7 : Aliénation et progrès
(On se
reportera aussi aux remarques faites à propos de l’étude de l’œuvre d’Albert
Memmi)
« Et combien ce tableau de l’espèce humaine,
affranchie de toutes ses chaînes, soustraite à l’empire du hasard comme à celui
des ennemis de ses progrès, et marchant d’un pas ferme et sûr dans la route de
la vérité, de la vertu et du bonheur, présente au philosophe un spectacle qui
le console des erreurs, des crimes, des injustices dont la terre est encore souillée,et
dont il est souvent la victime ! C’est dans la contemplation de ce tableau
qu’il reçoit le prix de ses efforts pour les progrès de la raison, pour la
défense de la liberté » . (Condorcet, Esquisse d’un tableau historique des
progrès de l’esprit humain, Paris, 1829).
XIXe siècle : croyance poursuivie dans le
« progrès » (démocratie de masse, progrès technique, rationalisation
la » icisation, etc.) mais aussi pessimisme (tyrannie de la masse et non
liberté politique ; isolement morbide et non autonomie de l’individu ;
rationalisation forcée de l’esprit et non pensée rationnelle ;
désenchantement stérile et non affranchissement des superstitions...).
« Les nouvelles tyrannies seront entre les mains
de commandos militaires qui se qualifieront de républicains. »
(Burckhardt, cité par Albert Salomon, The Tyranny of Progress, 1955).
Tocqueville :
l’aliénation comme réduction de l’homme
Tocqueville ne doute pas des « vertus » et
de l’inéluctabilité des « deux révolutions » (la politique et
l’économique). Mais il discerne parfaitement aussi le revers de la médaille...
Paradoxalement, l’individu a perdu une grande partie de signification du fait
de la la » icisation (fatale aux valeurs), de l’influence de l’opinion
publique et de la tyrannie majoritaire, de la division du travail, de la
rupture des liens communautaires, du relâchement de certaines vertus (honneur,
loyauté...) valorisant l’individu...
Effet corrosif de la démocratie sur le consensus
social (atomisation individualiste et égalitariste de la société). Des
obstacles de plus en plus considérables - les règles de l’avancement dans une
société démocratique égalitaire - à l’ascension sociale...
Marx : le travail comme
aliénation
Marx emprunte à Hegel (via les « hegeliens de
gauche » ) le terme d’aliénation, « dissociation radicale du moi
entre l’acteur et l’objet, entre le sujet tentant de maîtriser son propre
destin et un objet manipulé par les autres » (Daniel Bell). Chez Hegel, il
ne s’agit pas d’un état historique transitoire, mais un fait ontologique et
métaphysique : nous n’accèderons jamais à la liberté absolue, « ce
voyage dans l’espace, où nous nous trouvons seuls face à nous-mêmes, sans rien
au-dessous ni au-dessus de nous. » (Bell). Ce qui chez Hegel est
ontologique (de l’essence de la condition humaine) devient, chez les hegeliens
de gauche, sociologique : ainsi, à propos de la religion, Feuerbach... que
Marx réfute en faisant des relations économiques et non des croyances
religieuses l’agent décisif de l’aliénation.
« En quoi consiste l’aliénation du travail ?
D’abord, dans le fait que ce travail est extérieur à l’ouvrier, c’est-à-dire
qu’il n’appartient pas à son essence, que donc, dans son travail, celui-ci ne
s’affirme pas mais se nie, ne sent pas à l’aise, mais malheureux, ne déploie pas
une libre activité physique et intellectuelle, mais mortifie son corps et ruine
son esprit. En conséquence, l’ouvrier n’a le sentiment d’être auprès de
lui-même qu’en dehors du travail et,
dans le travail, il se sent hors de soi. (..) Son
travail n’est donc pas volontaire, mais contraint, c’est du travail forcé. Il
n’est donc pas la satisfaction d’un besoin, mais seulement un moyen de
satisfaire des besoins en dehors du travail. Le caractère étranger du travail
apparaît nettement dans le fait que, dès qu’il n’existe pas de contrainte
physique ou autre, le travail est fui comme la peste.
(..) Enfin le caractère extérieur à l’ouvrier apparaît dans le fait qu’il n’est
pas son bien propre, mais celui d’un autre, qu’il ne lui appartient pas, que
dans le travail l’ouvrier ne s’appartient pas lui-même, mais appartient à un
autre. » (Manuscrits de 1844, Editions sociales, 1968).
Chez Marx donc :
1. Aliénation ;
2. Aliénation historique (non
ontologique comme chez Hegel) ;
3. Alienation réductible à la propriété
privée (analyse très différente donc de celle de Tocqueville pour qui
l’aliénation résultait du système de production industriel (progrès technique
et division du travail) lui-même.
Engels : « ... un jour viendra où il n’y
aura plus manoeuvres ni architectes professionnels. (..) L’homme qui pendant
une demi-heure donnera des ordres en qualité d’architecte servira ensuite de
manoeuvre juqu’à ce que ses services en tant qu’architecte soient à nouveau
requis »
(Anti-Dühring). Cf. aussi l’Idéologie allemande.
« Que l’aliénation puisse exister (..) sous le
socialisme, que le socialisme puisse en fait apparaître comme un renforcement
de la bureaucratisation de l’esprit humain qui résulte aujourd’hui de la
démocratie de masse et du machinisme, que l’individu y soit encore plus isolé
qu’il l’est aujourd’hui des sources de son identité culturelle, qu’il y
disparaisse encore plus du fait de la routine et de la technologie, que la
volonté du peuple y soit encore plus détournée d’elle même sous l’effet des
forces « rationnelles » et « progressistes » qui sont à
l’oeuvre dans l’histoire, tout cela est totalement étranger au marxisme. Ces
thèmes sont au contraire bien présents chez Weber, chez Durkheim et chez
Simmel.
Weber :
la némésis du rationalisme
Pour Weber, le socialisme est peut-être inévitable
(compte tenu de la structure et du développement du capitalisme) mais il n’a
rien de bénéfique ; il ne fait qu’accentuer les caractéristiques du
capitalisme. Ce qui est en cause, c’est la bureaucratisation, la rationalisation
(ou instrumentalisation) des valeurs, l’aliénation de l’homme par rapport à sa
communauté et sa culture... La rationalisation finit par devenir sa propre
Némésis (divinité grecque personnifiant l’Indignation, la Vengeance des dieux
contre la démesure). Toutefois, Weber (comme Tocqueville) perçoit très bien ce
que l’égalitarisme et la rationalisation ont accompli de grandiose dans
l’Europe moderne et aussi leur caractère de nécessité historique.
« Nul ne sait encore qui, à l’avenir, habitera la
cage, ni si, à la fin de ce processus gigantesque, apparaîtront des prophètes
entièrement nouveaux, ou bien une puissante renaissance des pensers et des
idéaux anciens, ou encore - au cas ou rien de cela n’arriverait - une
pétrification mécanique, agrémentée d’une sorte de vanité convulsive. En tout
cas, pour les « derniers hommes » de ce développement de la
civilisation, ces mots pourraient se tourner en vérité :
« Spécialistes sans vision et voluptueux sans coeur » -, ce
néant s’imagine avoir gravi un degré de l’humanité jamais atteint
jusque-là. » (L’Ethique protestante).
Troisième
partie
Epilogue :
1/Lecture
de Nisbet « La tradition sociologique » pp 389-394
« épilogue »
Peut-on
considérer la période 1830-1890 comme l’âge d’or de la sociologie ?
A /
L’âge d’or
§1 :
âge d’or : selon Troeltsch période marquée par le passage d’un
fonctionnement social communautariste à un état de société laïque,
individualiste et rationaliste. S’ouvre une période de recherche d’équilibre
entre les deux ordres sociaux ; affrontements entre les deux tendances
génératrice d’idées nouvelles dans la culture.
§2 :
En fait la notion d’âge d’or ne peut être lue que de manière récurrente :
pour qu’une période puisse être nommée ainsi, il faut encore que les idées
qu’elle a inspirées aient été fécondes sur la longue période qui suit. Ainsi en
va-t-il du Vème siècle athénien qui a posé les bases de toute la philosophie
occidentale future.
§3 :
La période étudiée ne possède sans doute ni l’éclat ni le charisme de la
période Socratique. Mais au nombre des géants de la pensée qui l’ont peuplée et
animée, on peut tout de même y voir un creuset d’idées nouvelles, dont
l’apparition a été provoquée par le choc de deux ordres sociaux et
historique : celui de l’ancien régime et celui de la société industrielle
et libérale.
§4 :
On peut en outre relever que les concepts qui naissent à cette époque sont
déterminants pour l’analyse du développement intellectuel et de la pensée des
sciences sociales au XXème siècle. (communauté, autorité, statut, sacré, aliénation)
B/
Concepts dynamique ou sclérose de la pensée ?
§5 :
Qu’est ce qui permet au processus de renouveau intellectuel de perdurer au lieu
de se scléroser, sinon que le dynamisme dont sont porteurs les concepts
nouveaux initiés par ce risorgimento ?
§6
et 7 : Citation de Lowes sur les mutations sociales et littéraires :
« métaphore des coquilles vides
laissées par l’ancienne manière de penser qui, lorsqu’elles sont encore
malléables peuvent être investies par les nouvelles façons de penser, et qui
sont broyées lorsqu’elles ne sont plus que de simples formes vidées de leur
substance ».
§8 :
C’est ce que fait la sociologie contemporaine : elle se coule dans les
formes léguées par la tradition sociologique du XIXème siècle, qui s’avèrent
encore performantes pour analyser par exemple les mutations qui affectent les
nations jeunes des pays en voie de développement.
§9 :
Est-ce dire que les concepts de la sociologie de l’âge d’or ne conviennent qu’à
l’étude de phénomènes de mutation dont ses pères fondateurs étaient à la fois
témoins et acteurs ?
§10 :
Le concept de révolution a perdu de son dynamisme et de sa
lisibilité : on a tendance à nommer aujourd’hui tout changement des
habitudes révolution. Sans doute parce que les deux grandes révolutions,
démocratique et industrielle sont maintenant achevées. Elles ont accouché de
notre société et tout retour en arrière semble impossible.
§11 :
ainsi, les grandes antinomies qui caractérisaient la pensée des sociologues du
XIXème siècle risquent de ne plus être opérantes pour comprendre notre société,
puisque les mouvements cycliques des mutations ont achevé leur période de
gestation. Les oppositions portées par ces concepts sont de moins en moins
perceptibles au sein de la société actuelle.
C/
Que reste-il de la tradition sociologique du XIXème ?
§12 :
doit-on en conclure que la tradition sociologique est morte ? Sans doute
ses concepts seront-ils toujours source d’interrogations et de créations
nouvelles. Mais ce qui importe c’est que la tradition ne dégénère pas en routine :
elle n,’est sclérosante que si elle s’impose comme modèle de pensée à
reproduire : dans les sciences comme dans les arts, on ne peut se
contenter de reproduire ce qui a déjà été fait ou dit.
§13 :
Ainsi, la tradition sociologique du XIXème, en tant que réservoir de formes,
touche à sa fin. Sans doute surgiront demain les nouveaux Durkheim capable
d’initier une nouvelle approche des faits de société.
§14 :
Ce renouveau attendu ne sera pas le produit d’une instrumentation plus
performante : c’est au niveau des intuitions créatrice qu’il faut attendre
cette nouvelle approche de la réalité.
§15,
16 et 17 : citation de M. Morse :
« le savant, pour être créatif,
doit se détourner des ages systèmes de pensée qui ne nous apprennent que ce que
nous savons déjà ; il nous faut adopter une attitude eau moins aussi
créatrice que celle des demoiselles d’Avignon : celle d’un créateur de
formes novatrices. Il faut réveiller en nous notre part d’artiste : qui
renouvelle sans cesse son regard amoureux sur la réalité »
2/ proposition de corrigé :
La
période 1830-1890 est-elle déterminante pour l’analyse sociologique ?
Son
âge d’or est caractérisé par le conflit entre deux tendances, le
communautarisme et la démocratie. Cette confrontation est fertile en idées
novatrices, dont la portée réelle ne peut être appréciée que de manière
récurrente. Sans égaler l’/50 éclat du siècle de Périclès, cette
période a induit des idées éclairantes pour la compréhension des sciences
sociales.
Ce
risorgimento conceptuel, reste-t-il valable aujourd’hui ? Ses concepts ne sont-ils qu’une coquille vide
ou au contraire conservent-ils assez de souplesse pour rester pertinents ?
Certes, ils sont performants/100 quand on les applique aux jeunes sociétés en
mutation, mais pour la nôtre ? Peut-être ont-ils perdu en dynamisme et
lisibilité. Par exemple, la notion de révolution a perdu de sa force dans notre
société. Les grandes antinomies sociologiques du XIXème siècle ne sont plus
opérantes pour la comprendre. /150
Pour
autant, la tradition sociologique est-elle morte ? Ses concepts conservent
sans doute un dynamisme créatif, mais le danger est de sombrer dans la routine
d’une pensée sclérosée : on ne peut se contenter de répéter ce qui a déjà été
dit. Cette tradition touche à sa fin : à l’/200 instar des artistes qui initient de nouveaux
styles, les sociologues d’aujourd’hui doivent trouver en eux de nouvelles
intuitions. /219
M. Le Guen (2005)